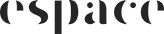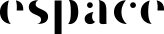Starving of Sudan de Xu Zhen : épistémologie et pragmatique du diorama
En art contemporain, l’usage du terme diorama remonte aux années 1990. L’intérêt qui se manifeste, à ce moment-là, pour les représentations tridimensionnelles de facture réaliste, à l’échelle ou de format réduit, comme celles percutantes de Jake & Dinos Chapman ou de Paul McCarthy, y participe considérablement. Le diorama, qui sert à désigner ces oeuvres ne formant pas un genre mais une modalité, n’est alors pas défini 1, ne l’étant pratiquement pas davantage aujourd’hui. Bien qu’il soit toujours exploité, et sans doute plus qu’il ne l’était il y a vingt ans, celui-ci reste encore à être explicité.
Retracer l’évolution du diorama pour s’interroger sur son sens et sa portée, pour inscrire épistémologiquement et pragmatiquement le diorama de l’art contemporain dans l’histoire d’un terme de ses pratiques, est une démarche prometteuse. Bien qu’il investisse et se réapproprie les formes dioramiques qui lui sont antérieures, le diorama de l’art contemporain n’est pas pareil au diorama muséal, les deux types de dispositifs n’étant pas non plus réductibles à l’invention de Daguerre datant de 1822 2. Les constructions de parcs d’attractions en tout genre, les modèles réduits et les jeux d’enfants sont d’autres sortes de dioramas, dont seule la première invente ou recrée des environnements grandeur nature 3 basés sur le trompe-l’oeil. L’illusion générée par l’échelle, qui reprend ou qui suggère celle de la réalité, y est déterminante. Elle l’est dans Starving of Sudan (2008), oeuvre controversée de Xu Zhen, qui sert ici à des fins inductives afin d’envisager le diorama grandeur nature. Dans cette oeuvre, le sol d’une galerie de Beijing est couvert de paille, les murs l’étant également d’arbres. Un automate de vautour et un enfant véritable donnent vie à une photographie connue du reporter Kevin Carter, qui montre un enfant soudanais affamé et convoité par un vautour. Carter, on s’en souviendra, reçoit pour cette photo le prix Pulitzer en 1994 ainsi que des critiques virulentes pour avoir privilégié l’image à l’enfant; il met fin à ses jours dans l’année.
Au sens étymologique, le diorama de Daguerre est inspiré du panorama 4. De racine grecque, son préfixe dia– signifie à travers et son suffixe, –orama, est lié à la vue, au fait de voir des spectacles. Le diorama de Daguerre est d’ailleurs un spectacle d’apparences qui attire des foules en quelque sorte amenées à voir au travers de la toile l’activité de la scène représentée. La toile, translucide, était mise en mouvement par des jeux d’éclairages qui l’animaient sporadiquement ou de manière continue et grâce auxquels, par exemple, une ruine antique reproduite fidèlement passait du lever du jour à la tombée de la nuit. L’ensemble, incluant parfois de véritables objets et même des êtres vivants 5, était présenté dans un théâtre aménagé aux fins du spectacle, plongeant ainsi le spectateur dans « l’illusion d’être confronté à des objets à l’échelle de son propre corps 6 ».
Le diorama de Daguerre mettait en relation l’art de la scène avec la peinture ainsi qu’avec l’installation et le son et lumière avant la lettre. Au-delà d’un divertissement populaire et d’un phénomène pré-cinématographique, il annonçait dans l’art contemporain l’intermédialité, l’approche documentaire, le diorama, bien sûr, et même la performance du spectateur, amené à se projeter dans l’oeuvre. Le diorama de Daguerre fonctionnait par oppositions, parfois « violentes 7 », comme celles entre la représentation de la réalité et l’existence concrète, le véridique et la fiction, la distance géographique et la promiscuité, le passé et le présent, la bidimensionnalité et la tridimensionnalité et, évidemment, la fixité et le mouvement. Ce genre d’oppositions, qui réunissent ce qui ne l’est normalement pas, est également déterminant dans les dioramas en art contemporain. Entre la photo de Carter et l’installation vivante de Zhen, entre l’Afrique du reporter et la Chine de l’artiste, entre la famine passée et l’actualité d’un art chinois muselé, enfin entre les médias qui encensent et « critiquent » et le public qui lui aussi dénonce mais participe, s’instaure une ambivalence féconde. Starving of Sudan exemplifie, de fait, l’usage du principe daguerrien en art contemporain, tout en révélant l’apport spécifique de l’art contemporain à ce principe. Par des jeux de contrastes, Daguerre voulait séduire, charmer, transporter son public. En art contemporain, on veut sans doute séduire mais aussi critiquer, dénoncer, ébranler. D’ailleurs, Xu Zhen est un artiste « provocateur 8 ».
Pour expliquer quel est le principal facteur ayant mené à un usage courant de la critique dans le diorama de l’art contemporain, revenons à l’évolution épistémologique. Le spectacle de Daguerre, auquel est rattachée la première définition du diorama, disparaît avec l’arrivée du cinéma au point qu’on le redécouvre actuellement 9. Mais le diorama reste vivant grâce aux musées qui en produisent dès 1875 10. La définition du diorama muséal est une « [c]omposition plastique consistant en l’évocation d’un paysage ou d’une scène exprimant un fait historique, à partir d’un décor en trompe-l’oeil disposé en vue frontale et de grande dimension, et parfois complété d’accessoires en trois dimensions… 11 » Au profit de la tridimensionnalité et de l’approche historique, donc, cette définition met de côté deux éléments déterminants dans l’oeuvre de Daguerre : le mouvement et le fantastique. De ce fait, elle exclut les jeux d’oppositions, du moins les principaux, et ce, à des fins didactiques.
En vérité, le diorama muséal a aussi pour but de séduire les masses 12. Cette volonté est par ailleurs gommée sous une visée éducative de transmission d’un savoir objectif que supporte sa définition et que critiquent auteurs et artistes postmodernes. Ils se mettent à dénoncer la fausse neutralité du diorama muséal. En prenant pour appui l’American Museum of National History de New York, par exemple, Donna Harraway démontre qu’ils témoignent tout autant des sociétés qui les créent que des mondes qu’ils montrent, par le choix des sujets et leur représentation 13. Et les artistes qui, comme nous le savons, opèrent une critique du musée à partir des décennies 1970 et 1980 trouvent dans le diorama une modalité avec laquelle ils arrivent à perturber « la séparation des champs disciplinaires que la modernité a opérée et dont le musée est l’héritier 14 ». Dans les années 1990, ils se mettent à exploiter cette modalité afin d’en changer la finalité d’éducative à subversive. Et ils l’exploitent aux fins de critiques croisées, entre autres, sur le patriarcat, le colonialisme, le sexisme, la consommation massive, l’anthropomorphisation et l’hypermédiatisation.
De Daguerre à l’art contemporain, en passant par Disney, ce qui opère dans le diorama grandeur nature dépend de l’illusion. Ces autres lieux, ces autres époques, ces autres mondes générés par une scène, un habitat, une taxidermie ou un personnage sont identificatoires. On dit des dioramas de Daguerre qu’ils faisaient oublier « la toile pour croire en la réalité 15 », qu’ils servaient à « duper 16 ». S’ils tiennent de l’illusion, les dioramas n’agissent pourtant pas par le leurre. Ils fascinent plutôt en suggérant un monde archétypal. Dans l’un des rares textes généraux, qui porte sur le diorama en art contemporain, Ralph Rugoff considère qu’ils constituent des formes liminaires de la réalité virtuelle : « [l]ike today’s virtual reality simulations, such displays were not meant to actually deceive the viewer so much as to offer a compelling substitute for the real world… 17 ». Je suis d’avis qu’ils annonçaient la réalité augmentée. Ils recréent la réalité en intégrant, le plus souvent, des choses véritables, combinant le vrai au factice (entre autres, les systèmes d’oppositions dont nous avons parlé). Ils la corrigent à ceci près qu’en art contemporain, les corrections ne servent pas à recréer un monde idéalisé, mais à révéler les travers de l’existence humaine.
Cela étant, la plupart des dioramas de l’art contemporain exploitent toujours le fort pouvoir de fascination qui vient des dioramas historiques. Ainsi en est-il même des compositions acerbes de Jake & Dinos Chapman ou de Paul McCarthy. Elles invitent au regard soutenu qui cherche dans chacun des détails la surprise scabreuse. En art contemporain, pour faire passer la critique, le stratagème de l’illusion dioramique séduit généralement, et ce, même dans les oeuvres les plus caustiques qui exploitent son attrait en poussant à l’extrême la relation qui unit séduction et répulsion.
L’affirmation ne s’applique toutefois pas à Starving of Sudan 18. De là tout l’intérêt de cette oeuvre, en exemple, qui est aussi un contre-exemple éclairant doublement l’objet de cet article. Par gêne, par malaise, parce qu’un humain, un enfant de surcroît, est exhibé pour rappeler la misère, le regard se détourne de cette oeuvre 19. Nul ne peut en être séduit, ni y rester étranger ou la critiquer de l’extérieur. En utilisant un enfant, l’artiste réactive la polémique entourant la photographie de Carter tout en interrogeant le principe fondateur des performances déléguées 20, des zoos humains et, par association, des parcs d’attractions que sont les zoos, le Biodôme et autres écosystèmes, dont les enclos sont des sortes de dioramas. L’oeuvre génère des questions d’éthique muséale 21 et artistique. Qu’est-ce à dire, en effet, que ces institutions qui exploitent le vivant sous le couvert du merveilleux ? Et que faut-il retirer d’oeuvres qui mettent en lumière le stratagème, précisément en le poussant à l’extrême ?
Nous l’aurons compris, si les sujets du diorama forment un point de mire, depuis au moins les années 1970, son dispositif agit toujours, pour sa part, en sourdine. Pourtant, son effet fantasmagorique, qui est systématiquement généré par des éléments en trompe-l’oeil n’étant pas strictement picturaux, constitue le fil rouge entre Daguerre, le musée, l’art contemporain et le parc d’attractions. Là réside sans doute l’essence du diorama qu’exploite et met à mal Xu Zhen.
Mélanie Boucher est professeure au programme de muséologie de l’Université du Québec en Outaouais. Son intérêt pour l’art contemporain s’est d’abord exercé principalement par le commissariat (Musée national des beaux-arts du Québec, Galerie de l’UQAM), puis par une thèse de doctorat en histoire de l’art, dont la version remaniée est publiée en 2014, sous le titre La nourriture en art performatif. Son usage, de la première moitié du 20e siècle à aujourd’hui, aux Éditions d’art Le Sabord. Ses présents travaux portent surtout sur le tableau vivant en art contemporain et l’évènementialisation des collections muséales.
-
Deux catalogues d’exposition portent sur le diorama en art contemporain. Toby Kamps et Ralph Rugoff, Small World: Dioramas in Contemporary Art, San Diego, Museum of Contemporary Art, 2000 ; David Revere McFadden, Otherwordly: Optical Delusions and Small Realities, New York, Museum of Arts and Design, 2010.
-
Le diorama est inventé par Louis Daguerre et Charles-Marie Bouton, mais il est développé et commercialisé par Daguerre.
-
Tous les dioramas comportent des éléments miniaturisés qui sont nécessaires au trompe-l’oeil. Sous les termes dioramas « grandeur nature » ou « à l’échelle », je regroupe les dispositifs qui en donnent l’impression.
-
André Desvallées et François Mairesse (dir.), Dictionnaire encyclopédique de muséologie, Paris, Armand Colin, 2011, p. 588.
-
Dans la « Vue du Mont Blanc prise de Chamonix », un chalet, des arbres, une grange, et même une chèvre vivante masquaient les contours de la toile. Raymond Montpetit, « Une logique d’exposition populaire : les images de la muséographie analogique », Publics et Musées, no 9, 1996, p. 63.
-
Guillaume Le Gall, La peinture mécanique : Le diorama de Daguerre, Paris, Mare & Martin, 2013, p. 29 et 31.
-
« Daguerre va chercher à peindre des événements tragiques qui mettent en scène des oppositions violentes », ibid., p. 41.
-
Nathalie de Vito, « Dérision et prohibition dans l’art de Xu Zhen », Parachute, no 114 (avril/juin 2004), p. [3].
-
L’ouvrage de Le Gall ainsi que le colloque international L’image en lumière : Histoire, usages et enjeux de la projection, organisé par Érika Wicky, Vincent Lavoie et Johanne Lalonde, membres du groupe de recherche Figura, et présenté les 22 et 23 mai 2014 à l’Université du Québec à Montréal, témoignent du phénomène.
-
Montpetit, op. cit., p. 63.
-
André Desvallées et François Mairesse (dir.), op.cit., p. 588.
-
Michael Belcher, Exhibitions in Museums, London et Washington, Leicester University Press et Smithsonian Institution Press, 1991, p. 61.
-
Ellis Burcaw rappelle, quant-à-lui, l’expression d’un stéréotype sexiste dans un vieux diorama de lions du Smithsonian Natural History Museum, qui a fait la manchette et dans lequel le mâle chasse, tandis que les femelles se prélassent, ce qui est l’inverse en réalité. George Ellis Burcaw, Introduction to Museum Work, Walnut Creek et Toronto, Altamira Press, 1997 [1984], p. 140-141.; Donna Haraway, « Teddy Bear Patriarchy: Taxidermy in the Garden of Eden, New York City, 1908-1936 », Social Text, no 11 (hiver 1984-1985), p. 20-64.
-
Ces propos de Gilbert Lascault, qui portent sur les musées d’artistes, sont repris par Anne Bénichou dans Un imaginaire institutionnel. Musées, collections et archives d’artistes, Paris, L’Harmattan, coll. « esthétiques », 2013, p. 16.
-
Émile de la Bedolière, cité dans Le Gall, op. cit., p. 86.
-
Louis Vitet cité dans Le Gall, op. cit., p. 92.
-
Ralph Rugoff, « Bubble Worlds », dans Toby Kamps et Ralph Rugoff, op. cit., p. 13.
-
Katherine Don, « Xu Zhen: Long March Space », Art in America (mai 2009), p. 168.
-
Ibid., p. 168.
-
Il interroge surtout celles dans lesquelles des non-professionnels exploitent un aspect de leur identité. Sur les performances déléguées, voir Claire Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, London et Brooklyn, Verso, 2012, p. 219-239.
-
Les zoos, le Biodôme et autres écosystèmes du genre sont des institutions muséales.