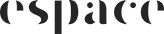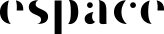La restauration, un acte de collaboration entre l’artiste et le restaurateur
Les activités professionnelles des restaurateurs sont traditionnellement fondées sur la préservation des matériaux originaux d’un objet culturel. Le principe de cette activité associe étroitement la notion d’intégrité matérielle originelle de l’objet à celle de son authenticité ; c’est ce que signalent les articles du Dictionnaire encyclopédique de muséologie à propos de la restauration 1. À titre d’exemple d’application de cette conception, mentionnons cette prescription du Code de déontologie canadien en matière de conservation à l’effet que le restaurateur doit respecter l’intention originelle du créateur du bien culturel, se renseigner sur l’intégrité physique, conceptuelle, historique ou esthétique de ce bien et la respecter dans toutes ces interventions 2. Cette recommandation évoque la théorie de la restauration de Cesare Brandi qui a guidé l’instauration des programmes de formation des restaurateurs. Ce théoricien a défini la restauration comme « le moment méthodologique de la reconnaissance de l’oeuvre d’art dans sa consistance physique et sa double polarité esthétique et historique 3 ». Et il a dicté aux restaurateurs de préserver son état matériel originel parce que, en tant que trace de l’acte de création, il est porteur de sa signification historique ; et c’est par la préservation de cet état qu’ils peuvent assurer la pérennité de la valeur artistique de cette oeuvre et l’authenticité de son expérience esthétique.
Les sculptures contemporaines dotées d’un potentiel de variabilité ont mis en cause cette conception de l’authenticité de l’oeuvre d’art fondée sur son intégrité matérielle d’origine. Cette variabilité se manifeste de différentes façons : elle peut s’incarner dans l’éphémérité des matériaux, l’obsolescence technologique, ou encore la contingence de ces sculptures à leur contexte d’exposition. Ces modes de manifestation ont incité les professionnels des musées, dont les restaurateurs, à entreprendre une réflexion sur les normes ou les conventions fondant leurs activités professionnelles. Doivent-ils s’opposer à toute modification de l’état d’origine de ces oeuvres tridimensionnelles afin de conserver les traces matérielles du contexte socioculturel d’où elles sont issues, ou doivent-ils davantage préserver leur identité conceptuelle qui renvoie à l’intention de l’artiste ? Quels éléments physiques de ces oeuvres doivent alors être privilégiés pour sauvegarder leur intégrité et leur authenticité ? Les réponses qu’ils ont données à ces questions, lors d’interventions dans des colloques ou de la publication d’articles, indiquent qu’ils tentent de maintenir un équilibre entre la préservation de leur matérialité originelle et le respect de leur variabilité.
Documenter l’identité de l’oeuvre d’art
Ainsi, il y a quelques années, Pip Laurenson, qui fut la première restauratrice des nouveaux médias à la Tate Modern Gallery, a proposé aux restaurateurs de remplacer la notion d’état matériel originel par le concept d’identité de l’oeuvre d’art afin de rendre compte de la spécificité des installations médiatiques, dont les modes de manifestation diffèrent de la sculpture monolithique conventionnelle. Elle a relevé qu’elles se déroulent dans une durée déterminée et qu’elles associent les traits physiques de la sculpture à des composantes performatives ; de plus, leurs dispositifs techniques pouvant devenir obsolètes sont fréquemment objet de migration ou d’émulation technologique. Afin de composer avec cette variabilité de l’installation médiatique, Pip Laurenson a encouragé ses collègues à entreprendre un travail de collaboration avec son auteur afin de documenter les éléments constituant son identité, ce qui concerne autant ses composantes matérielles, son fonctionnement technique et les modalités de sa mise en vue que l’effet esthétique recherché. Elle a fait valoir la portée normative de cette documentation en considérant que l’application des renseignements consignés devait garantir l’authenticité des prestations de l’oeuvre. Par ailleurs, elle a reconnu que l’identité de l’installation médiatique n’est pas obligatoirement stable, mais qu’elle peut se construire au rythme de ses réexpositions 4. Elle a cependant recommandé aux restaurateurs de ne pas aborder sa variabilité comme étant totalement ouverte, en veillant à ce que celle-ci ne porte pas atteinte à l’intégrité conceptuelle et matérielle de l’oeuvre dont les conditions ont été établies par la documentation 5.
La conjugaison des savoirs de l’artiste et du restaurateur
Ce rôle déterminant accordé à la documentation est aujourd’hui bien intégré dans les activités de ces professionnels des musées. Par exemple, Richard Gagnier, chef du laboratoire de restauration du Musée des beaux-arts de Montréal, partage avec Pip Laurenson cette préoccupation de maintenir un équilibre entre le respect des instructions de l’artiste et l’exercice de la compétence du restaurateur. Il affirme qu’afin d’assurer la pérennité de l’intégrité matérielle et conceptuelle de l’oeuvre d’art, « la déontologie de la restauration en art contemporain nécessite le savoir combiné du conservateur, du restaurateur et de l’artiste 6 ».
Cette posture professionnelle axée sur la collaboration entre l’artiste et le restaurateur et la réunion de leurs savoirs est également au coeur du projet de recherche intitulé Inside Installations. Preservation, Presentation of Installation Art, qui a réuni des restaurateurs et des conservateurs oeuvrant dans des musées européens ayant acquis des installations 7. L’objectif de cette recherche a été de fixer les conditions de la pérennité de cette catégorie d’oeuvres contemporaines en établissant des protocoles de leur conservation et de leur exposition, dont les conditions sont étroitement associées à leur identité 8. Les participants à ce projet ont aussi donné à la documentation un rôle d’intermédiaire décisif pour établir les composantes de cette identité. D’une part, ils ont placé l’artiste au centre de ce processus en lui donnant le statut d’un véritable collaborateur au sein de leur réseau professionnel. Ils ont eu recours à des méthodes de cueillette de renseignements qui relèvent d’une véritable recherche ethnographique sur le travail artistique. Des artistes ont déposé des documents, mais, le plus souvent, ils ont réalisé avec eux des entretiens contenant de l’information que les artistes n’avaient jamais systématiquement consignée. Ce qui leur a permis de transmettre leur savoir qui, tout en étant d’ordre conceptuel, implique aussi des savoir-faire propres à des processus de fabrication, à des dispositifs techniques ou à des qualités des matériaux utilisés au cours du processus de création et qui sont jugés essentiels à l’authentification de l’exposition de leurs oeuvres, et plus globalement à leur conservation. D’autre part, ce savoir sur les installations a aussi été constitué par les analyses des restaurateurs. Leur expertise a été appliquée dans les étapes suivantes de la recherche : la description de l’état matériel de ces oeuvres, la constitution du récit de leurs expositions, l’identification des variations qu’elles ont suscitées et l’évaluation de leur effet sur leur intégrité originelle. Ces renseignements ont servi à produire un guide de leur mise en vue qui regroupe des documents écrits, des diagrammes, des photographies ou des images vidéo. On y trouve une description détaillée de leurs composantes matérielles, de leur mode d’occupation de l’espace d’exposition, ainsi qu’une présentation des étapes de leur montage. Ce guide constitue le véritable script 9 de ces oeuvres installatives puisqu’il exerce un rôle normatif en désignant les modalités de leur présentation comme constituant leur version autorisée devant servir de modèle aux itérations ultérieures. Ce guide démontre aussi que les installations ont incité les restaurateurs en art contemporain à étendre l’application de leur expertise aux conditions de mise en vue de l’installation, qui constituent dorénavant un objet de leurs pratiques.
La documentation de Doppelgarage (2002) de Thomas Hirschhorn, acquise en 2005 par la Pinacothèque d’Art Moderne de Munich, est exemplaire des résultats obtenus par le projet de recherche Inside Installations. Preservation, Presentation of Installation Art 10. Lors de sa mise en vue inaugurale à la galerie Arndt and Partner, en 2003, cette oeuvre complexe occupait un espace de cent vingt mètres carrés constitué de deux pièces reliées par un couloir ; quatre cents objets trouvés ou fabriqués avec des matériaux provenant de l’environnement de la vie quotidienne occupaient le sol et les murs de ces pièces 11. Afin d’établir une stratégie de sa conservation, les restaurateurs et les conservateurs de la Pinacothèque d’Art Moderne de Munich ont posé les questions suivantes : Est-ce que Doppelgarage doit être classée comme objet unique dont l’authenticité est fondée sur son intégrité matérielle d’origine ? Ou est-elle une oeuvre à caractère conceptuel et performatif dont le trait distinctif est son éphémérité ou la détérioration de ses matériaux ? Se référant au processus de sa création, ils ont retenu que l’intention de l’artiste sur ce sujet est ambiguë : d’une part, il a donné à ses assistants des instructions très précises concernant la forme des objets et leur localisation dans l’espace, faisant ainsi jouer à la matérialité un rôle déterminant dans la production du sens ; d’autre part, il n’a pas tenu au maintien absolu de son état originel en permettant au musée de remplacer les composantes abîmées. Les restaurateurs ont alors mis en place une stratégie de conservation adaptée à cette position de l’artiste, bien que le principe de préservation de l’état originel des composantes de cette installation ait guidé la restauration d’une partie importante de ses éléments. L’équipe de restauration a procédé à une minutieuse description de ses caractéristiques physiques. Elle a identifié les éléments d’origine jugés déterminants pour maintenir l’intégrité et les modalités de sa perception esthétique, et elle a consenti à la détérioration de matériaux qu’elle a jugés ne pas porter radicalement atteinte à son intégrité matérielle. Le restaurateur de la Pinacothèque d’Art Moderne de Munich, Maike Grün, a cependant admis que cette fixation de l’état de l’oeuvre par ce travail des restaurateurs pourrait être éventuellement mise en cause par des expositions de l’oeuvre susceptibles de générer des variations.
La posture de ce restaurateur à l’égard de Doppelgarage est exemplaire de prises de décisions concernant d’autres oeuvres installatives étudiées par le projet Inside Installations. Preservation, Presentation of Installation Art. Elles témoignent de l’application simultanée de deux modèles de stratégies visant l’établissement de leurs conditions de pérennité. L’un relève de la fidélité des restaurateurs au paradigme de la théorie institutionnalisée de la conservation voulant, dans la mesure du possible, le maintien de l’intégrité de l’état originel de l’oeuvre afin de préserver sa signification historique ; alors que l’autre atteste de leur ouverture à l’idée que cet état n’est pas définitivement fixé, mais que les conditions de sa variabilité doivent être définies par l’expertise du restaurateur, en collaboration avec l’artiste. Cette prise de position est partagée par les restaurateurs d’art contemporain, comme l’illustre ce commentaire de Richard Gagnier : « On prend par rapport à l’oeuvre des décisions qui respectent l’intention de l’artiste, mais qui tendent à saisir ce qui doit être absolument maintenu de sa matérialité originale ou renouvelable afin d’assurer l’authenticité pérenne de l’objet 12. »
Francine Couture est professeure associée au Département d’histoire de l’art de l’UQÀM. Elle prépare la publication d’un ouvrage collectif qui paraîtra en 2013 aux Éditions MultiMonde (collection « Cahiers de l’Institut du patrimoine »), portant sur la thématique de la réexposition et de la pérennité des oeuvres contemporaines. Cette publication s’inscrit dans la continuité de ses travaux de recherche se rapportant au sujet de l’exposition, et plus globalement aux relations de l’art contemporain avec l’institution artistique.
-
Dictionnaire encyclopédique de muséologie, sous la direction d’André Desvallées et de François Mairesse, Paris, Armand Colin, 2011.
-
Guide de déontologie et guide du praticien de l’Association canadienne pour la conservation et la restauration des biens culturels et de l’association canadienne des restaurateurs professionnels, Troisième édition, 2000, p. 1.
-
Cesare Brandi, Théorie de la restauration, Paris, Institut national du patrimoine, 2001, p. 30.
-
Pip Laurenson, Mapping the Studio II (2001), de Bruce Nauman, http://www.tate.org.uk/research/tateresearch/majorprojects/nauman/themes_4.htm.
-
Pip Laurenson, « Vulnerabilities and Contingencies in the Conservation of Time-based Media Works of Art », Inside Intallations. Theory and Practice in the Care of Complex Artworks, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2011, p. 35-39.
-
« De l’intégrité de l’oeuvre d’art afin d’assurer sa juste pérennité », un entretien mené par Justine Lebeau avec Richard Gagnier, restaurateur en art contemporain. Muséologies, volume 5, no 1, automne 2010, p. 193.
-
Pour une analyse détaillée des résultats de ce projet de recherche, lire Francine Couture, « Mise en cause ou persistance du principe de la pérennité de l’état originel de l’oeuvre d’art ? », à paraître dans Culture et musée, 2013.
-
Tatje Scholte, “Introduction,” Inside Installation, Theory and Practice in the Care of Complex Artworks, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2011, p. 11-20. http://www.sbmk.nl/uploads/inside-installations-kl.pdf
-
La notion de script désigne le document qui fixe le scénario pouvant être écrit, mais aussi dessiné et photographié, servant à guider la réinstallation des oeuvres et à préserver leur mémoire ou leur pérennité. Didier Semin, Le peintre et son modèle déposé, Genève, Mamco, 2001.
-
Thomas Hirschhorn, Doppelgarage (2002), http://www.sbmk.nl/uploads/inside-installations-kl.pdf
-
Maike Grun, “My Work Isn’t Ephemeral, It’s Precarious, Discussion Of A Conservation Strategy For Doppelgarage By Thomas Hirschhorn,” Inside Installation. Theory and Practice in the Care of Complex Artworks, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2011, p. 221-234.
-
« De l’intégrité de l’oeuvre d’art afin d’assurer sa juste pérennité », un entretien mené par Justine Lebeau avec Richard Gagnier, restaurateur en art contemporain. Muséologies, volume 5, no 1, automne 2010, p. 193.