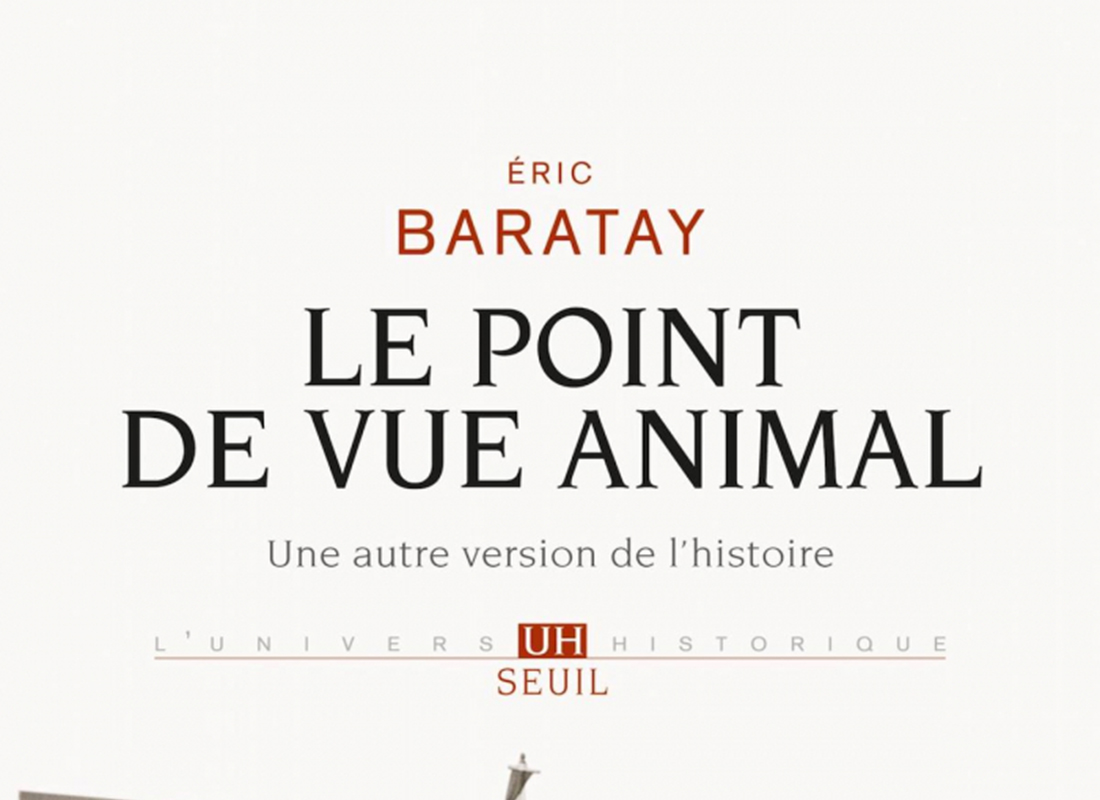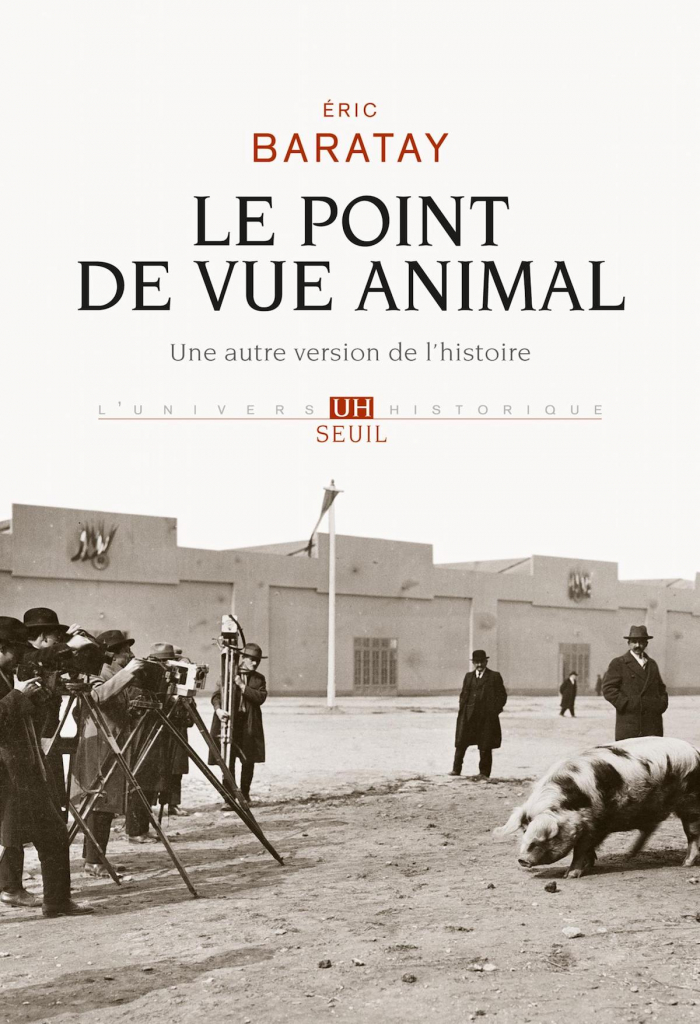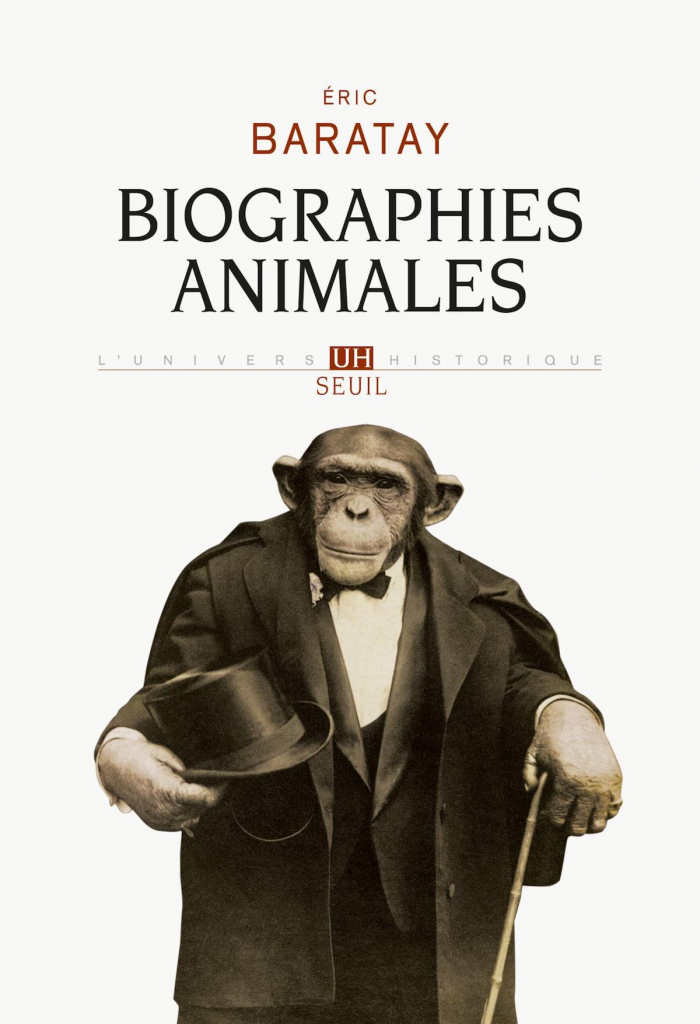Du point de vue animal : un entretien avec Éric Baratay
Bénédicte Ramade : En 2012, vous avez publié Le point de vue animal. Une autre version de l’histoire (éd. du Seuil), ouvrage à partir duquel s’est établie une façon inédite de penser le rapport entre l’humanité et l’animalité. Cinq ans plus tard, en 2017, chez le même éditeur, votre livre les Biographies animales. Des vies retrouvées mettait à l’épreuve ce point de vue animal – celui d’une girafe, d’un âne; mais aussi de chimpanzés et de chiens – jusque dans le style littéraire, qui cherchait à développer une restitution personnelle à chaque animal, à créer un style en écho au récit de leur vie. Comment comprendre votre cheminement ?
Éric Baratay : Dans Le Point de vue animal, il y avait l’aspect méthodologique – quelles sources convoquer, comment faire et croiser –, mais il n’y avait pas cette facette de la restitution de l’aspect personnel d’un animal. S’est ensuite posée la question de l’écriture pour justement faire passer cette dimension individuelle. Comment prendre le point de vue animal d’un individu ? Ce n’est pas la même chose finalement que dans Le point de vue animal ou dans Les bêtes des tranchées (éd. CNRS, 2013), car il s’agissait de groupes. On peut essayer de prendre leur point de vue sur tout ce qui est conditions de vie, travail, mais l’approche individuelle n’est alors pas présente. Et ne se pose pas la question : comment faire passer le point de vue d’un individu ? C’est pourtant la question la plus importante selon moi, ce qui n’était pas évident à adopter; et là, j’ai trouvé de l’aide du côté des artistes et des écrivains. Ce dont je me suis aperçu, c’est que c’est un travail assez ancien en fait. L’expressionniste allemand Franz Marc s’est intéressé à ce point de vue animal dès avant la Première Guerre mondiale. Un tableau comme Voilà comment mon chien voit le monde 1 montre un paysage géométrisé regardé par Russi, son chien blanc assis. Les artistes et les écrivains ont posé la question les premiers. À la fin du 19e siècle, le photographe Édouard Batut avait photographié des chiens en se mettant à leur hauteur. Parce que les artistes et les écrivains n’ont pas à apporter de preuve scientifique, ils peuvent expérimenter librement, un travail fondamental qui nous ouvre la voie. Chez les écrivains, le meilleur exemple est selon moi dans Flush de Virginia Woolf (1933), la biographie d’un chien. Il y a certes beaucoup d’anthropomorphisme, mais quelques pages sont saisissantes lorsqu’elle relate la visite de Rome à hauteur de chien, par la description des odeurs et non par la vue. La volonté de prendre le point de vue de l’animal est manifeste. Bien sûr, ce sont des exemples isolés, ce n’est pas aussi répandu que de nos jours.
La période 1880-1930 avait été très favorable aux animaux en Occident et après, tout s’était effondré jusqu’aux années 1980-1990 lorsque l’Occident s’est jeté dans un culte de maîtrise de la nature. Ce point de vue animal n’est redécouvert que depuis une trentaine d’années. On ne peut plus dissocier les arts de la science, les concordances sont trop fortes. Les scientifiques ne peuvent pas penser le point de vue animal si cela n’a pas été imaginé avant, sans cette préparation des esprits qui s’est faite en toute liberté, affranchie des raisons de la scientificité.
Diriez-vous qu’il existe une école française de cette pensée animale singulière ?
É. B. : Ce qui a été développé durant les années 1980 jusqu’aux années 2000, et cette approche reste majoritaire notamment dans les pays anglo-saxons, c’est l’approche culturelle. Car même si elles sont dénommées Animal Studies, ce sont avant tout des approches culturelles où se retrouvent sociologues, historiens, philosophes… Cette approche est désormais bien reçue et considérée. Depuis, se développe l’approche « point de vue animal » ou l’histoire animale des animaux. Lorsque mon ouvrage est paru en 2012, certains se sont dit que ce n’était pas possible, et ce, malgré une soixantaine de pages consacrées à la théorie et des exemples pour le prouver. Les plus réticents ont été les sociologues et les ethnologues. De la même manière que les premiers sont arrivés tardivement en France à cette histoire des animaux, ils sont aujourd’hui réticents à cette approche animale des animaux. Beaucoup d’entre eux sont des littéraires et n’ont pas envie d’aller se coltiner l’éthologie, la génétique, les sciences dites dures, etc. Cette réticence est d’ailleurs palpable aussi chez les éthologues. Chacun entretient sa prudence disciplinaire.
C’est une discipline dans laquelle il faut accepter de ne pas être absolument spécialiste, c’est un aveu d’incompétence avec lequel il faut savoir travailler, un véritable exercice d’humilité…
É. B. : Oui, et personnellement, c’est ce qu’il y a de plus intéressant. Faire toujours la même histoire ne m’intéresse pas. Ainsi, dans le champ de l’histoire culturelle qui est très à la mode depuis les années 1980, on assiste à une répétition acharnée. Les sujets sont neufs, mais la méthodologie est toujours la même. Je veux éviter cela.
Peut-on tout reprendre, revoir du point de vue animal ? Est-ce une méthode extensive ?
É. B. : Je pense qu’on pourra un jour tout revoir, et écrire une histoire humaine du côté animal. Relire nos événements historiques à l’aune de l’animalité. Ce sera d’autant plus indispensable que passer du côté des animaux permet de mieux comprendre le côté humain. Dans ma démarche, je m’intéresse à des animaux parce qu’ils sont intéressants en eux-mêmes, mais aussi parce que cela permet de mieux comprendre les hommes si on se tient du côté animal.
Ce point de vue animal répond-il d’une nécessité éthique, morale, écologique ou politique ?
É. B. : Dans mon esprit, c’est une conséquence. Mon livre, Le point de vue animal, vient avant tout de l’objectif scientifique. Après avoir travaillé sur l’histoire humaine des animaux, j’ai eu le sentiment d’un déséquilibre entre les histoires, et le sentiment que cela ne pouvait pas marcher. Si on veut aborder l’histoire concrète des relations, l’histoire des hommes ne se fait pas sans celle des animaux. Sinon, ce serait supposer que l’animal est passif, qu’il est une machine, un objet. Mais cela ne marche plus scientifiquement, ainsi que le montre très bien l’éthologie contemporaine. C’est ce qui m’a poussé à développer ce côté animal. Personnellement, je suis partisan d’une revalorisation du monde animal, mais je n’ai pas fait d’objectif politique de cette démarche citoyenne. Les objectifs sociétaux et politiques de mes travaux sont plutôt des conséquences.
Comment doser l’empathie pour son sujet afin que l’écran subjectif, émotionnel, sentimental, n’opacifie pas le sujet ?
É. B. : C’est une exigence fondamentale pour moi. Ce genre de travail peut avoir des implications sociétales, politiques, être efficace, à condition d’être sérieux et de ne pas se laisser dépasser par les implications politiques, qu’elles l’emportent sur la recherche et de perdre son auditoire. Il est fondamental d’éviter cela. Si on reste neutre, cela permet aux gens qui ne sont pas convaincus, dans l’incertitude, de réfléchir d’une manière plus libre, car ils peuvent vous faire confiance, sans avoir peur d’être tirés vers la caricature, une vision larmoyante.
Vous avez trouvé une forme d’écriture qui est une épreuve pour le lecteur, usant d’un style télégraphique saccadé pour traduire le ressenti du taureau mis à mort, graphiquement distincte, une véritable expérience physique de la lecture. Mais cela ne peut pas être un modèle universel…
É. B. : Pour la corrida écrite du point de vue du taureau Islero, j’ai réussi à le faire sur quinze pages, mais de là à faire un livre entier… je me pose la question de la lisibilité. Dès le départ, je voulais une écriture différente d’un animal à l’autre pour montrer que l’on pouvait varier les approches, les styles, les méthodes selon les espèces. Comme on ne sortira pas de l’anthropomorphisme – nous ne sommes que des hommes –, il ne faut pas que la forme de l’écriture empêche le fond. Il convient de tenir un équilibre. Étendre le point de vue animal à l’histoire globale au niveau du fond, oui, l’étendre à l’écriture, je ne suis pas sûr.
Les animaux ne sont pas des ventriloques…
É. B. : Tout à fait. C’est une tendance asymptotique. On se rapproche, mais on n’atteindra jamais tout à fait ce point de vue. Nous restons des humains, on crée des mots à partir des caractéristiques animales. Inventer des mots, trouver une écriture pourrait rapprocher les démarches littéraires et artistiques d’une dimension scientifique.
1. Hund vor der Welt, 1912, huile sur toile, 118 x 83 cm, collection privée, Suisse.
Éric Baratay est membre de l’Institut universitaire de France, professeur d’histoire à l’université de Lyon III-Jean-Moulin, spécialiste de l’histoire des relations hommes-animaux auxquelles il a consacré de nombreuses recherches. Après des études consacrées à l’animal et l’église, la corrida, et l’histoire des jardins zoologiques, il a publié Le point de vue animal au Seuil, 2012; Bêtes des tranchées. Des vécus oubliés au CNRS, 2013 et Biographies animales. Des vies retrouvées au Seuil, 2017. Il prépare actuellement un nouvel ouvrage sur le chat.
Bénédicte Ramade est historienne de l’art, spécialisée dans l’art écologique auquel elle a consacré son doctorat. Ses recherches les plus récentes consacrées à l’Anthropocène l’ont amenée à étudier le déploiement des humanités environnementales dans le champ de l’histoire de l’art et la portée des études animales dans la révision du primat anthropocentrique. Bénédicte Ramade est chargée de cours à l’Université de Montréal et à l’Université du Québec à Montréal, critique d’art et commissaire indépendante.